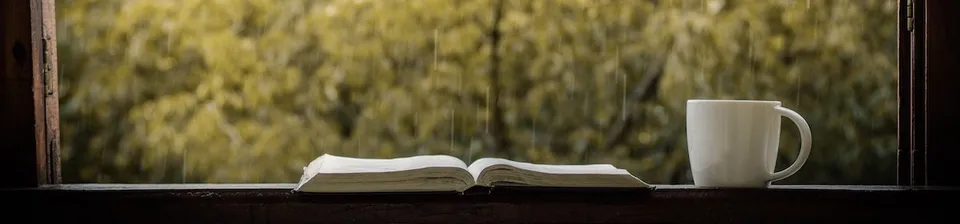Le sujet est une fonction.
Le sujet dépend toujours du verbe.
Le sujet est non supprimable (c’est un élément indispensable à la construction d’une phrase).
Le sujet donne au verbe (noyau du groupe verbal) son nombre, sa personne et parfois son genre.
Le sujet est :
-
celui qui fait l’action ;
-
celui qui subit l’action ;
-
celui qui est dans l’état exprimé dans le verbe ;
-
le bénéficiaire de l’action ;
-
la cause de l’action ;
-
le lieu de l’action ;
-
l'instrument de l’action :
etc.
La phrase dit quelque chose à propos du sujet.
Cette information s’appelle le prédicat (il apporte une information sur le sujet).
Cet artiste expose chaque année dans notre galerie.
COMMENT RECONNAÎTRE LE SUJET ?
On l’isole au moyen du présentatif : c’est … qui
Ou on pose la question : qui est-ce qui ? ou qu’est-ce qui ?
NATURE DU SUJET
Nom ou groupe nominal
Les écureuils sautent de branche en branche.
Pronom ou groupe pronominal
Nous sommes arrivés.
Infinitif ou groupe infinitif
Courir permet de se sentir libre.
Subordonnée conjonctive
Que tu réussisses tes examens est très important.
Subordonnée relative substantive
Qui vole un œuf vole un bœuf.
Le pronom impersonnel “il” (toujours sujet)
Il se passe quelque chose.
ANAPHORE DU SUJET
Répétition du sujet en tête de plusieurs propositions successives (pour souligner sa présence) :
Et Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière des ténèbres ; Dieu appela la lumière jour ; et les ténèbres nuit. (la Bible, genèse 1,35)
ELLIPSE DU SUJET
Le sujet n’apparaît pas dans la phrase.
ELLIPSE DU SUJET OBLIGATOIRE
Dans une phrase injonctive
Envoyez-moi votre CV.
Avec l’infinitif délibératif (le locuteur s’interroge sur ce qu’il doit faire)
Que dire ?
Quand commencer ce travail ?
ELLIPSE DU SUJET POSSIBLE
Quand plusieurs verbes ont le même sujet
Ils commencèrent ce travail puis décidèrent finalement de le reprendre plus tard..
Quand on veut adopter un style télégraphique
A voté (il / elle a voté)
Doit être plus attentif en classe.
A l’oral
Faut pas rêver.
Y a du monde.
Dans certaines tournures archaïques
Peu me chaut. (peu m’importe)
PLACE DU SUJET DANS LA PHRASE DÉCLARATIVE (OU AFFIRMATIVE)
SUJET PLACÉ AVANT LE VERBE DANS LA PHRASE DÉCLARATIVE (OU AFFIRMATIVE)
Le sujet est généralement placé avant le groupe verbal auquel il se rattache
Le chien court dans la campagne.
Le sujet peut être séparé du verbe par d’autres éléments mobiles dans la phrase (compléments circonstanciels, adverbes, etc.) :
La municipalité, pour répondre à la demande, construit de nouveaux logements sociaux.
Le sujet peut être détaché et repris (ou annoncé) par un pronom sujet.
C’est une dislocation (uniquement à l’oral) :
Ce train, il est toujours en retard.
INVERSION DU SUJET DANS LA PHRASE DÉCLARATIVE (OU AFFIRMATIVE)
Inversion du sujet obligatoire
Dans les propositions incises :
Cette histoire, dit-il, est tout à fait incroyable.
Inversion du sujet recommandée à l’écrit
Avec certains adverbes en tête de phrase :
À peine, ainsi, aussi, aussi bien, bientôt, sans doute, peut-être, tout au plus, et encore, du moins, encore, etc.
Bientôt viendra l’été.
Aussi avons-nous décidé de partir.
Quand le sujet est un peu long :
On peut placer un adverbe ou un groupe nominal complément circonstanciel en début de phrase et inverser le sujet.
Ainsi se succédèrent l’automne, l’hiver et le printemps jusqu’à ce qu’arrive enfin l’été.
Dans une belle pagaille se mêlaient des bus, des voitures, des vélos, des motos, des scooters.
Inversion du sujet possible (à l’oral et à l'écrit)
Après un verbe transitif du type “survient, entre, reste” en tête de phrase :
Reste ce problème.
Après un adjectif attribut placé en tête de phrase :
Grande fut sa déception quand il découvrit sa note.
Après certains compléments circonstanciels placés en tête de phrase :
Sous le pont Mirabeau coule la Seine. (Guillaume Apollinaire, le Pont Mirabeau)
Dans une phrase de structure attributive :
Immense est son talent.
Dans une phrase exclamative (l’inversion du sujet n’est pas possible avec certains mots exclamatifs) :
Est-il drôle ! Cet acteur est-il drôle !
Dans une subordonnée relative avec un pronom relatif complément :
Les comptines que chantent les enfants sont très jolies.
Dans une subordonnée circonstancielle
-
de temps :
Quand vient la pluie, le soleil n’est jamais loin.
-
de but :
Nous avons tout fait pour que se réalisent nos rêves.
-
de comparaison :
Nous rions comme riraient des enfants.
PLACE DU SUJET DANS L’INTERROGATION DIRECTE TOTALE
L’interrogation totale concerne la phrase entière.
Elle appelle une réponse par “oui” ou par “non”.
Nom, groupe nominal ou pronom placé avant le verbe
(parfois à l’oral dans le langage familier. L’intonation suffit.)
Tu viens ?
Ordre sujet-verbe rétabli avec la locution “est-ce que”
Est-ce que + sujet + verbe
(à l’oral et à l’écrit)
Est-ce que tu viens ?
Sujet inversé (placé après le verbe)
Inversion simple (usage soigné)
Quand le sujet est un pronom (“je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles” ou “ce”)
Le sujet est placé après le verbe.
Verbe + pronom (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles, ce)
As-tu essayé de modifier ton mot de passe ?
Est-ce possible ?
Viens-tu ?
Inversion complexe (usage soigné)
Le sujet est :
-
un nom, un groupe nominal,
-
ou un pronom autre que “ce” ou que “je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles”.
Il reste placé avant le verbe mais il est repris par un pronom personnel de troisième personne (il, elle, ils, elles) placé après le verbe :
Sujet + nom, groupe nominal, pronom autre que “ce” ou que “je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles” + verbe + pronom personnel (il, elle, ils, elles)
Ces légumes coûtent-ils cher ? (le sujet est un groupe nominal)
Ton chien court-il vite ? (le sujet est un groupe nominal)
Le tien court-il vite ? (le sujet est un pronom autre que “ce” ou que “je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles”)
TRAITS D’UNION ET “t” EUPHONIQUE DANS LES SUJETS INVERSÉS
Penser au trait d’union dans les sujets inversés
Entre le verbe et le pronom placé après lui.
Où pars-tu pendant tes vacances ? Viendras-tu ? Es-tu arrivé ?
Ajouter un “t” euphonique (à la troisième personne du singulier)
On intercale un “t” après “a” et “e” devant “il, elle, on” (pour éviter l’hiatus)
et on place un trait d’union de part et d’autre du “t” :
Viendra-t-elle ? L’aime-t-elle ? Le saura-t-on ?
PLACE DU SUJET DANS L’INTERROGATION DIRECTE PARTIELLE
L’interrogation partielle porte sur un élément de la phrase.
Elle comporte toujours un mot interrogatif.
On ne peut pas y répondre par oui ou par non.
Nom, groupe nominal ou pronom sujet, placé avant le verbe
Parfois à l’oral (langage familier). L’intonation suffit.
Sujet + verbe
Tu fais quoi ?
On mange quand ?
Ordre sujet-verbe rétabli
À l’écrit et à l’oral.
Avec les locutions “est-ce que, qu’est-ce que, à qui est-ce que”, etc. :
Qu’est-ce que + pronom personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) sujet + verbe
Qu’est-ce que tu fais ?
Avec les locutions adverbiales “où est-ce que”, “quand est-ce que”, “pourquoi est-ce que”, etc.
Où est-ce que / quand est-ce que + sujet + verbe
Où est-ce que vous allez ?
Sujet inversé (placé après le verbe) avec des adverbes en début de phrase
Au choix, selon les cas :
Inversion simple
Usage courant.
Quand le sujet est :
-
un nom, un groupe nominal
-
ou un pronom personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles”) :
Adverbe + verbe + sujet (nom, groupe nominal ou pronom personnel)
Quand part le train ?
Où ira ce train ?
Pourquoi irions-nous là-bas ?
Où irez-vous ?
Inversion complexe
Quand le sujet est un nom ou un groupe nominal.
Le sujet est placé avant le verbe et il est repris par un pronom de troisième personne (il, elle, ils, elles) :
Adverbe + sujet (nom ou groupe nominal) + verbe + pronom personnel (il, elle, ils, elles)
Quand le train part-il ?
Où ce train ira-t-il ?
Pourquoi ce train est-il en retard ?
Combien ces légumes coûtent-ils ?
Comment vas-tu ?
Sujet inversé avec le pronom interrogatif “que”
Que + verbe + sujet
Que fais-tu ?
Sujet inversé avec les mots interrogatifs “quel, quels, quelle, quelles”
Quel (+ complément) + sujet
Quelle destination choisirons-nous ?
Quelles sont les meilleures destinations ?
Sujet inversé avec les pronoms représentants “lequel, lesquels, laquelle, lesquelles” (le + quel)
et leurs formes contractées “auquel, auxquels, auxquelles” (à + lequel)
Lequel / auquel + verbe + sujet
J’ai pris plusieurs photos. Laquelle préfères-tu ?
Avec le pronom interrogatif “qui”
Qui + verbe
L’interrogation porte sur le sujet :
Qui a réalisé ce chantier ?
Avec ses formes renforcées* “qui est-ce qui / qu’est-ce qui”, “à qui est-ce que”
Qui est-ce qui / qu’est-ce qui / à qui est-ce que + verbe
Qu’est-ce qui miaule et chasse les souris ?
A qui est-ce que tu vas porter ce plat ?
(*forme renforcée : locution nominale formée à partir de “est-ce que” et “est-ce qui”)
TRAITS D’UNION ET “t” EUPHONIQUE DANS LES SUJETS INVERSÉS
Penser au trait d’union dans les sujets inversés
Entre le verbe et le pronom placé après lui.
Où pars-tu pendant tes vacances ? Viendras-tu ? Es-tu arrivé ?
Ajouter un “t” euphonique (à la troisième personne du singulier)
A la troisième personne, on intercale un “t” pour éviter un hiatus et on place un trait d’union de part et d’autre du “t” :
A-t-il lu ce livre ?
PLACE DU SUJET DANS L’INTERROGATION INDIRECTE TOTALE
L’interrogation indirecte totale est introduite par la conjonction “si”.
Elle porte sur toute la phrase.
Sujet placé avant le verbe
J’ignore si je peux commencer ce travail.
PLACE DU SUJET DANS L’INTERROGATION INDIRECTE PARTIELLE
L’interrogation partielle porte sur une partie de la phrase (on ne peut pas y répondre par oui ou par non).
Sujet placé avant le verbe
Quand le sujet est le pronom démonstratif “ce” ou un pronom personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils) :
Il demande quand nous partons.
Sujet placé après le verbe
Obligatoire dans une interrogation partielle, avec “quel” et “qui” attributs :
Il demande quel est le problème.
Je me demande qui est le responsable.
Sujet placé avant ou après le verbe
Inversion simple
Uniquement pour un autre sujet que “je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles, ce”.
Dans les autres interrogations partielles :
Il demande quand arrive le responsable. / Il demande quand le responsable arrive.
Je me demande où sont passées mes clés / Je me demande où mes clés sont passées.
L’épithète est un mot, un groupe de mots ou une proposition qui fait partie du groupe nominal et qui le complète.
LA NATURE ET LA PLACE DE L'ÉPITHÈTE
Un adjectif
Avant le nom (antéposé)
-
quand il qualifie un nom suivi d’un complément du nom :
Le chaud soleil de juillet ; le doux chant du rossignol.
-
adjectifs courants et courts :
Un vieux vélo ; un petit meuble ; un jeune auteur ; un joli bouquet.
-
épithètes de nature (caractéristique traditionnellement attribuée à la personne ou à la chose) :
Les vertes prairies (les prairies sont toujours vertes)
Le bouillant Achille (Achille est connu pour avoir un tempérament bouillant)
-
expressions figées :
Un fieffé menteur ; pleurer à chaudes larmes
-
valeur affective ou appréciative :
Une merveilleuse surprise.
Une incroyable nouvelle.
De noirs pressentiments.
-
“feu” se place avant le déterminant :
Feu son père.
Après le nom (postposé)
-
quand il exprime une propriété objective (couleur, forme, etc.) :
Un pantalon noir ; des volets verts
-
quand il est suivi d’un complément :
Une personne sûre d’elle.
-
le nom peut être suivi de plusieurs adjectifs :
Un ciel gris et orageux.
Avant et après le nom
Un petit chemin ombragé.
Un groupe adjectival
Après le nom :
Une personne sûre d’elle ; une décision difficile à prendre.
Un participe présent employé comme adjectif épithète
Après le nom :
Un poste vacant.
Un participe passé employé comme adjectif épithète
Après le nom :
De la vaisselle lavée.
Un groupe participial employé comme adjectif épithète
Après le nom :
Les élèves jouant dans la cour ; les livres laissés de côté.
Un adverbe employé comme adjectif épithète
Après le nom qu’il complète :
Une personne bien.
Un nom sans déterminant employé comme épithète
Après le nom qu’il complète :
Un remède miracle.
Une proposition subordonnée relative adjective introduite par un mot relatif
Après le nom qu’elle complète :
La promenade que nous avons faite.
L’ATTRIBUT DU SUJET
Il est un constituant du groupe verbal.
Il exprime une caractéristique du sujet qui peut être :
-
un état :
Je suis étonnée.
-
une propriété :
Il est grand.
-
un statut :
Elle est professeur de français.
-
l’appartenance à une catégorie :
Le soleil est une étoile.
-
un verbe occasionnellement attributif :
Ils sont revenus épuisés. (on pourrait dire : ils sont épuisés)
CONSTRUCTION DE L’ATTRIBUT DU SUJET
Il se construit avec deux types de verbes :
-
Un verbe d’état (être, devenir, paraître, rester, sembler, demeurer, avoir l'air, passer pour, etc.).
Quand l'attribut est construit avec un verbe d’état, il ne peut pas être supprimé.
-
Un verbe occasionnellement attributif (naître, vivre, mourir, sortir, partir, rentrer, revenir, tomber).
(un verbe occasionnellement attributif est un verbe d’action qui peut être remplacé par le verbe être)
NATURE DE L’ATTRIBUT DU SUJET
Adjectif
Adjectif qualificatif :
Ce cheval me paraît nerveux.
Adjectif verbal :
Cette situation est gênante.
Participe passé employé comme adjectif
Elle semble pressée.
Nom ou groupe nominal
Sa ville natale est Tours.
Groupe prépositionnel
Il passe pour un original.
Il est d’un naturel joyeux.
Pronom ou groupe pronominal
Cette chaise est la mienne.
Cette chaise est celle de ta sœur.
Infinitif ou groupe infinitif
Apprendre, c’est grandir.
Adverbe employé comme adjectif
Ils sont devant.
Proposition subordonnée
Conjonctive complétive :
L’idéal serait que nous arrivions tous à la même heure.
Conjonctive circonstancielle (temps ou condition) :
Le pire, c’est quand tu pars sans rien dire.
Relative (à valeur substantive) :
Son préféré n’est pas qui tu crois.
PLACE DE L’ATTRIBUT DU SUJET
L’attribut du sujet se place avant le verbe quand il est
-
un pronom personnel conjoint :
Je suis contente d’avoir fini ce travail. Et toi, l’es-tu ?
-
un pronom relatif :
Si étonnant que cela paraisse, il n’a rien entendu.
-
un pronom interrogatif ou un nom accompagné d'un déterminant interrogatif ou exclamatif :
Qui est cet homme ? Quel père est-il auprès de ses enfants ?
-
mis en tête de phrase pour marquer la liaison avec ce qui précède (“tel”, “tout autre”, “autre chose”…)
Telle était l’opinion qu’il avait de nous.
-
mis en évidence en tête de phrase :
Terrible fut son courroux.
Dans les autres cas, l'attribut du sujet se place après le verbe
ACCORD DE L’ATTRIBUT DU SUJET
Quand l'attribut du sujet est un adjectif ou un participe passé
Il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet :
Cette femme est élégante. Ces femmes sont élégantes.
quand l’attribut du sujet est un nom ou un groupe nominal
Il a souvent le même nombre et parfois le même genre que le sujet :
Ces airs sont des compositions originales.
Sa fille est une brillante avocate.
Quand l’attribut du sujet est une expression figée
Il ne s’accorde pas :
Cette personne est l’ennemi du bien.
Dans l’expression “être cause de”
Il ne s’accorde pas :
Ces événements sont cause de notre retard.
L’ATTRIBUT DU COMPLÉMENT D’OBJET DIRECT (COD)
Il exprime un caractéristique du COD (même rôle que l’attribut du sujet) :
-
état ;
-
propriété ;
-
statut :
Elle considère Léa comme sa meilleure amie. (Elle considère que Léa est sa meilleure amie.)
Il ne fait pas partie du groupe COD (il ne subit pas de transformation quand on remplace le COD par un pronom) :
Je trouve cette personne bien agressive. → Je la trouve bien agressive.
Il ne peut généralement pas être supprimé sans que soit modifié radicalement le sens de la phrase :
J’ai trouvé ton gâteau excellent. (j’ai trouvé que ton gâteau était excellent)
J'ai trouvé ton gâteau. (j’ai trouvé ton gâteau à la boulangerie)
CONSTRUCTION DE L’ATTRIBUT DU SUJET
Il se construit avec cinq types de verbes :
-
verbes qui expriment un jugement :
penser, croire, juger…
Je juge cette méthode très efficace.
-
verbes qui expriment une transformation :
faire, rendre…
Cet incident nous a rendus plus prudents.
-
verbes qui expriment une dénomination :
appeler, nommer…
Mon directeur m’a nommé chef de projet.
-
verbes occasionnellement attributifs :
Elle a ramené son chien complètement trempé. (Elle l’a ramené complètement trempé)
-
le verbe “avoir” :
Il a les yeux bleus.
NATURE DE L’ATTRIBUT DU COD
Adjectif
Il juge cette attitude tout à fait condamnable.
Adjectif verbal
Je trouve cet enfant remuant.
Participe passé
Je te crois grisé par le succès
Nom ou groupe nominal
Ils ont appelé leur fille Albertine. Je le crois très bon professeur.
Groupe prépositionnel
Il te considère comme son meilleur ami. Il me prend pour toi.
Infinitif ou groupe infinitif
Je n’appelle pas cela faire attention.
Subordonnée relative attributive
Elle a les mains qui tremblent.
Adverbe employé comme adjectif
J’ai vu ton grand-père. Je l’ai trouvé bien.
PLACE DE L’ATTRIBUT DU COD
Après le COD quand le COD et l’attribut du COD suivent tous les deux le verbe :
Je trouve ton plat délicieux.
Avant le COD quand le COD et l’attribut du COD suivent tous les deux le verbe mais que le COD est nettement plus long que l’attribut :
Je trouve délicieux le plat que tu as préparé ce midi.
L’ATTRIBUT DU COI
Il exprime une caractéristique du COI.
CONSTRUCTION DE L’ATTRIBUT DU COI
L’attribut du COI peut se construire avec des verbes tels que user de,se servir de, faire de.
On peut remplacer ces verbes par le verbe être.
NATURE DE L’ATTRIBUT DU COI
Nom ou groupe nominal
Je fais de cette idée un point de départ pour mon projet. (cette idée est un point de départ)
Ils se servent de cette entreprise comme intermédiaire pour leurs négociations. (cette entreprise est un intermédiaire).
Le mot mis en apposition apporte une précision sur le groupe nominal tout entier.
Il désigne la même personne ou la même chose que le groupe nominal qu’il complète.
Il est séparé du groupe nominal qu’il complète par une ou deux virgules.
NATURE DES ÉLÉMENTS POUVANT ÊTRE MIS EN APPOSITION
Groupe nominal détaché avec déterminant
Il désigne la même personne ou la même chose que le groupe nominal qu’il complète.
→ Place : après le groupe nominal qu’il complète.
Mozart, le compositeur de “La Flûte enchantée”, fait partie de l’école classique.
Groupe nominal détaché sans déterminant
Il désigne la même personne ou la même chose que le groupe nominal qu’il complète.
→ Place : avant ou après le le groupe nominal qu’il complète.
Grand compositeur du XVIIIe siècle, Mozart a composé près de neuf cents œuvres.
Mozart, grand compositeur du XVIIIe siècle, a composé près de neuf cents œuvres.
Groupe prépositionnel détaché
Uniquement quand il a un sens proche d’un adjectif.
→ Place : avant ou après le groupe nominal qu’il complète.
Ce mathématicien, d’une grande modestie, refuse les honneurs (modeste)
D’une rigueur exceptionnelle (très rigoureux)
Adjectif détaché
→ Place : mobile dans la phrase.
Impatients, les chiens tiraient sur leur laisse pour avancer plus vite.
Les chiens, impatients, tiraient sur leur laisse pour avancer plus vite.
Les chiens, tiraient sur leur laisse pour avancer plus vite, impatients.
Groupe adjectival détaché
→ Place : mobile dans la phrase.
Prêts à partir, les sprinters attendent le signal de départ.
Les sprinters attendent le signal de départ, prêts à partir.
Les sprinters, prêts à partir, attendent le signal de départ.
Infinitif en position détachée
Il peut jouer le rôle d’un nom ou d’un groupe nominal :
→ Place : après le nom qu’il complète.
J’ai une préoccupation : trouver un travail.
Participe présent
Il peut jouer le rôle d’un adjectif dans un groupe nominal étendu et exercer la fonction apposition.
→ Place : avant ou après le groupe nominal qu’il complète.
Le marathonien, s’arrêtant, minimise ses chances de victoire.
Participe passé
Il peut jouer le rôle d’un adjectif dans un groupe nominal étendu et exercer la fonction apposition.
→ Place : avant ou après le groupe nominal qu’il complète.
La dessinatrice, concentrée, imagine de nouveaux personnages pour illustrer cette histoire.
Groupe participial
→ Place : avant ou après le groupe nominal qu’il complète :
Victor Hugo, attaché à la paix et à la liberté et sensible à la misère humaine, s'est exprimé en faveur de nombreuses avancées sociales.
Attaché à la paix et à la liberté et sensible à la misère humaine, Victor Hugo s'est exprimé en faveur de nombreuses avancées sociales.
Proposition subordonnée relative adjective détachée
→ Place : après le groupe nominal qu’elle complète :
La Montagne Sainte-Victoire, qui est située près d’Aix-en-Provence, est un thème récurrent chez le peintre Paul Cézanne.
Proposition subordonnée conjonctive détachée
→ Place : après le groupe nominal qu’elle complète.
La théorie d’Einstein - qu’il existe une équivalence entre l’énergie et la masse de matière d’un système donné - tient en une formule : E=mc2.
Expression par laquelle le locuteur attire l’attention de son interlocuteur en le désignant.
Elle est séparée du reste de la phrase par une virgule.
NATURE DES MOTS POUVANT EXERCER LA FONCTION D’APOSTROPHE
Un nom ou un groupe nominal
Le plus souvent, le nom commun se présente sans déterminant.
Les enfants, à table !
Monsieur, vous avez oublié votre manteau.
Garçon, deux cafés !
Marcel, arrête !
Un pronom personnel de deuxième personne du singulier ou du pluriel, de forme disjointe
(forme disjointe : forme que prend le pronom quand il est séparé du verbe ou employé sans verbe)
Toi, tu viendras me voir après le cours.
Ce pronom peut recevoir une expansion :
Vous qui avez lu le livre, qu’en avez-vous pensé ?
SÉQUENCE (OU COMPLÉMENT) D’UNE FORME IMPERSONNELLE
Groupe de mots complément des verbes impersonnels ou des locutions verbales ayant pour sujet impersonnel “il”.
-
Verbes ou locutions météorologiques (verbe évoquant le temps qu’il fait) au sens figuré :
Il pleut des compliments.
-
Verbes “être” et “avoir” dans les présentatifs il est, il y a :
Il y a des nuages dans le ciel.
Il est temps de partir.
-
Verbes ou locutions verbales ayant pour sujet “il” (Il faut, il est question de, il en va ainsi, il s’agit de, il est à noter que, etc.) :
Il me faudrait un peu plus de temps.
Imagine la patience qu’il a fallu.
Il s’agit de ton avenir !
Il est question d’arrêter de fabriquer des bouteilles en plastique.
Ce n’est pas vraiment un complément d’objet.
SÉQUENCE (OU COMPLÉMENT) D'UNE CONSTRUCTION IMPERSONNELLE
Groupe de mot qui suit le verbe :
-
dans une phrase impersonnelle et qui correspond au sujet dans la phrase personnelle correspondante :
Il est tombé beaucoup de pluie. (beaucoup de pluie est tombée)
Il a été décidé une conférence spéciale pour expliquer la situation.
-
dans la mise au passif de certains verbes transitifs directs :
Il sera répondu à votre courrier.
Ce n’est pas vraiment un complément d’objet.
Le COD est un complément essentiel du verbe. Il ne peut pas être supprimé.
Il peut :
-
préciser l’action du verbe :
Elle a attrapé un joli papillon.
-
ou être mis en relation avec le sujet par le verbe concerné (il n’est alors affecté par aucune action) :
Ce problème me concerne.
Ce sujet intéresse tout le monde.
Il se construit directement après le verbe, sans préposition :
Elle a attrapé un joli papillon.
Il répond à une question en “qui” ou en “quoi” :
Qu’a-t-elle attrapé ? Elle a attrapé un papillon.
Un verbe à la voix passive n’a jamais de COD : quand on transforme une phrase de la voix active à la voix passive, le COD devient sujet.
Ici, on a retrouvé un fossile d’ammonite. (un fossile d’ammonite est le COD du verbe à la voix active)
→ Ici a été retrouvé un fossile d’ammonite. (un fossile d’ammonite est le sujet inversé du verbe à la voix passive)
NATURE DU COD
Nom ou groupe nominal
As-tu vu mes lunettes de soleil ?
Pronom ou groupe pronominal
Non, mais j’ai trouvé les miennes.
Infinitif ou groupe infinitif
J’aime méditer.
Proposition conjonctive
Je sais que je ne sais rien (Socrate, IVe siècle avant J.-C.).
Proposition interrogative indirecte
J’aimerais savoir comment atteindre ce sommet.
Proposition exclamative indirecte
J’admire comme tu es serein.
Proposition relative (à valeur substantive)
Je logerai qui voudra.
Proposition infinitive
Les vaches regardent passer le train.
PLACE DU COD
Le COD est généralement placé après le verbe.
Il peut être placé avant le verbe :
-
quand il est un pronom personnel conjoint :
Je te crois. (mais à l’impératif et au positif : Crois-moi.)
-
quand il est un pronom relatif :
Le travail que j’ai fini.
-
dans des interrogations directes portant sur le COD :
Quelle saison préfères-tu ?
-
dans une tournure présentative du type “c’est… que” :
C’est un livre que j’ai beaucoup apprécié.
-
dans certaines expressions figées :
Grand bien vous fasse.
Il se construit indirectement après le verbe, à l’aide d’une préposition.
C’est un complément essentiel du verbe. Il ne peut pas être supprimé.
Il est introduit par les prépositions à, de ou pour, contre, avec, après, sur, en, etc.
La préposition qui introduit le COI est déterminée par le verbe et non par le sens de la phrase :
Je donne des vêtements à une association.
Mon amie s’occupe de mon chat.
Je lutte contre de mauvaises habitudes.
Nous travaillons sur un dossier important.
Je ne vote pour personne.
Il répond à la question à qui ? de qui ? à quoi ? de quoi ? avec qui ? avec quoi ? sur quoi ? après qui ? etc.
NATURE DU COI
Groupe prépositionnel
préposition + nom ou groupe nominal
Je m’occuperai des plantes de votre terrasse pendant votre absence.
préposition + pronom ou groupe pronominal
Je m’occuperai aussi de celles du salon.
préposition + infinitif ou groupe infinitif
Je m’occuperai de les arroser et de les tailler.
Proposition
-
conjonctive à fonction complétive (à ce que, de ce que…)
Je m’attends à ce qu’il fasse chaud.
-
relative à valeur substantive (à qui, à quoi, à quiconque)
Je parle à qui je veux.
Pronom personnel
Noms animés
-
pronoms conjoints :
lui, leur :
Il leur téléphone. (Il téléphone à…)
Parle-lui.
-
pronoms disjoints :
(à) lui, (à) elle, (à) eux, (à) elles :
Il pense à eux.
-
pronoms disjoints :
(d’)elle, (de) lui, (d’)eux, (d’)elles
Il parle de lui.
(contre) lui, (contre) elle(s), (contre) eux, (pour) lui, (pour) elle(s), pour (eux), (en) lui, (en) eux, etc.
Il a voté contre cette candidate. → Il a voté contre elle.
Noms inanimés
-
pronom adverbial :
y
Il y pense. (il pense à …)
-
pronom adverbial :
en
Il en parle. (il parle de…)
-
pronoms conjoints :
lui, leur
Ces problèmes sont graves. Il faut leur porter attention. (il faut porter attention à…)
-
sans pronom :
contre, pour
Il a voté contre.
Il arrive que les pronoms “y” et “en” renvoient à une personne :
C’est un commerçant malhonnête. Ne vous y fiez pas.
Le complément d’objet second est un complément d’objet indirect employé avec un COD.
C’est un complément d’objet indirect qui complète un verbe déjà complété par un complément d’objet direct.
Verbe + COD + COI (COS)
Le professeur distribue les copies aux élèves.
NATURE DU COS
Nom, groupe nominal, pronom, groupe pronominal :
Les élèves rendent leurs copies au professeur.
LE COMPLÉMENT (OU DATIF) D’INTÉRÊT
Ce sont les pronoms personnels me, moi, te, lui, nous, vous, leur qui désignent le bénéficiaire de l’action.
Ils sont compléments d’objet indirect et sont utilisés avec un complément d’objet direct.
Il lui enverra un message.
Il me prépare un repas.
Prépare-moi un repas.
Je te prêterai mes affaires.
Dessine-moi un mouton. (Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince)
LE DATIF PARTITIF
Ce sont les pronoms personnels me, moi, te, lui, nous, vous, leur qui désignent la personne à qui appartient le tout de la partie désignée par le complément du verbe.
Je lui ai coupé les cheveux.
(lui : datif partitif : il désigne le tout)
(les cheveux : complément du verbe. Il désigne la partie)
Il m’ a marché sur le pied.
(m’ : complément du verbe. Il désigne la partie)
(le pied : complément du verbe. Il désigne la partie)
LE DATIF ÉTHIQUE
Pronom personnel de la deuxième personne du singulier utilisé quand le locuteur souhaite impliquer affectivement son destinataire dans l’action en le prenant à témoin.
Uniquement à l’oral dans le langage familier.
Te + pronom personnel + verbe + COD
Il te lui a passé un de ces savons !
Le complément d’agent correspond, dans la phrase passive, au sujet de la phrase active.
-
voix active :
Le maraîcher cultive les légumes.
-
voix passive : auxiliaire “être” + participe passé
Les légumes sont cultivés par le maraîcher.
Il fait partie du groupe verbal.
Il n’est pas toujours exprimé :
Ses gâteaux sont toujours très appréciés.
Son sérieux est apprécié.
NATURE DU COMPLÉMENT D’AGENT
Groupe prépositionnel introduit par la préposition “par”
Les légumes sont cultivés par le jardinier.
Les plats sont préparés par le chef cuisinier.
Groupe prépositionnel introduit par la préposition “de”
Avec les verbes de sentiment ou avec des constructions indiquant le résultat de l’action.
Le lierre recouvre le mur. → Le mur de l’allée est recouvert de lierre. (indication d’un résultat)
Tous apprécient son sérieux. → Son sérieux est apprécié de tous. (verbe de sentiment)
Tes recettes sont appréciées de tous.
Il indique une caractéristique du sujet (mesure, prix, durée, etc.).
Il se rencontre surtout avec les verbes mesurer, peser, coûter, valoir, durer, vivre.
Il fait partie du groupe verbal (c’est un complément essentiel du verbe).
Il se construit directement, sans préposition.
Ce n’est pas un complément d’objet direct.
Il ne peut pas devenir sujet d’une phrase passive. (on ne peut pas dire : trente tonnes sont pesées par cette statue)
Pour reconnaître le complément de mesure, on utilise le mot “combien”.
Cette statue pèse trente tonnes.
Ce pommier mesure quatre mètres.
Ce collier lui a coûté cent euros.
La cuisson ne doit pas durer plus de douze minutes.
Les verbes qui peuvent se construire avec un complément de mesure peuvent aussi, avec un sens différent, recevoir un COD :
S’étant rendu compte de son erreur, le stagiaire a dû peser à nouveau tous les lots de bananes.
Avec un sens différent, ces verbes peuvent recevoir un COD.
Le participe passé s’accorde alors avec le COD placé avant lui :
“coûter” n’est pas toujours utilisé pour une somme d'argent : Le musicien explique toutes les difficultés que lui a coûtées la composition de cette symphonie.
“vivre” peut avoir le sens de “passer ou mener” : Je me souviens des moments que nous avons vécus ensemble.
NATURE DU COMPLÉMENT DE MESURE
Groupe nominal
Son règne a duré vingt ans.
Pronom ou groupe nominal
Combien coûte cette commode ? (pronom interrogatif)
Cela ne vaut rien. (pronom indéfini)
Adverbe ou groupe adverbial
Ce livre coûte cher.
Le trajet a duré assez longtemps.
Il exprime un lieu (point de départ, point d’arrivée, lieu qu’on traverse, etc.).
Il est appelé par le sens du verbe et désigne donc un lieu sur lequel s’exerce l’action du sujet.
Il n'exprime pas une circonstance de l’action.
Il se rencontre avec un verbe de mouvement se rendre, aller, venir, entrer, etc.
Il fait partie du groupe verbal (c’est un complément essentiel du verbe).
Certains compléments essentiels de lieu peuvent être supprimés.
Ce n’est pas un complément d’objet indirect.
Il est généralement introduit par une préposition (à, vers, de, loin de, etc.)
Ce colis vient du Mexique.
Il se rend à Lyon.
Sauf quand le complément désigne une rue, une place, etc. :
La manifestation arrive Place de la Bastille.
NATURE DU COMPLÉMENT ESSENTIEL DE LIEU
Groupe prépositionnel (groupe de mots introduit par une préposition)
La préposition précise le sens du complément en relation avec le verbe :
arriver à, aller vers… sortir de, courir après, tourner autour de, s’écraser contre, passer par, parvenir à, jusqu’à…
Groupe nominal sans préposition
Quand le complément désigne une rue, une place, etc. :
Ils sont allés place de l’Etoile puis ils se sont rendus place de la Concorde.
Le présentatif est une expression plus ou moins figée qui sert à présenter une personne ou une chose.
Le présentatif associé à “que” ou à “qui”, peut servir à extraire un élément de l’énoncé.
TROIS TYPES DE PRÉSENTATIFS
C’est / ce n’est pas
Ce présentatif précise l’identité.
Nature des compléments du présentatif “c’est / ce n’est pas”
Nom, groupe nominal, pronom :
C’est un château. C’était un château. Ce sont des châteaux.
C’est moi. C’est toi. Ce n’est pas lui. C’est nous. Ce n’est pas vous. Ce sont eux.
C’est … qui, c’est … que / ce n’est pas … que, ce n’est pas … qui
“C’est” est associé à “qui” ou à “que” et sert ainsi à extraire un élément de l’énoncé (extraction).
Nature des éléments mis en relief par “c’est … qui, c’est … que / ce n’est pas … qui, ce n’est pas … que”
Nom, groupe nominal, pronom :
C’est Claude Monet qui a peint les nymphéas.
C’est au musée de l'Orangerie que nous avons pu admirer les Nymphéas de Claude Monet.
Ce n’est pas du sel qu’il me faut.
Il y a / il n’y a pas
Ce présentatif indique l’existence ou la présence.
Nature des compléments du présentatif “il y a / il n’y a pas”
Nom, pronom, groupe nominal, groupe pronominal, proposition subordonnée conjonctive complétive :
Il n’y a pas de problème. Il faut qu’il y ait du beau temps pour partir en vacances. Il y a toi. Il y a que je ne suis pas d’accord.
Il y a … qui, il y a … que
“Il y a” est associé à “qui” ou à “que” et sert ainsi à extraire un élément de l’énoncé (extraction).
Nature des éléments mis en relief par “il y a … qui, il y a … que”
Nom, groupe nominal, pronom, adverbe :
Il y a quelqu’un qui essaie de te joindre.
Il y a trois heures que j’attends.
Il n’y a longtemps que j'attends.
Il n’y a que … qui ; il n’y a que … que / il n’y pas que … qui, il n’y pas que … que
Nature des éléments mis en relief par “il n’y a que ... qui, il n’y a que … que / il n’y pas que … qui, il n’y pas que … que”
Nom, groupe nominal, pronom, adverbe :
Il n’y a qu’en automne que l’on trouve des châtaignes.
Il n’y a que toi qui saches résoudre ce problème.
Il n’y a qu’ici que …
Il est / il n’est pas
Ce présentatif indique l’existence, la présence ou le temps.
Nature des compléments du présentatif “il est / il n’est pas”
Nom, groupe nominal, adverbe :
Il est huit heures.
Il était une fois.
Il n’est pas tard.
Voici, voilà
Ces présentatifs indiquent la survenue.
Nature des compléments des présentatifs “voici, voilà”
Nom, groupe nominal, pronom, proposition subordonnée complétive conjonctive, proposition subordonnée interrogative indirecte partielle :
Me voici ! (pronom personnel)
Voilà le courrier ! (groupe nominal)
Voilà que le train a encore du retard. (subordonnée conjonctive)
Voici comment nous allons procéder. (subordonnée interrogative indirecte partielle)
Voici … qui, voici que, voilà … qui, voilà que
“Voici” et “voilà” sont associés à “qui” ou à “que” et servent ainsi à extraire un élément de l’énoncé (extraction).
Nature des éléments mis en relief par “voici … qui, voici que, voilà … qui, voilà que”
Nom, groupe nominal, pronom :
Voici le document que vous m’avez demandé.
Voilà le train qui arrive.
Voilà trois heures que j’attends. (cette extraction s’accompagne de la disparition de la préposition “depuis” : j’attends depuis deux heures)
Le comparatif évalue la qualité par comparaison avec un élément de référence : il compare un élément à un autre ou à d’autres qui possèdent la même propriété.
Le comparatif d’infériorité est exprimé par moins … que
Le comparatif d'égalité est exprimé par aussi … que
Le comparatif de supériorité est exprimé par plus … que
NATURE DU COMPLÉMENT DU COMPARATIF
Nom ou groupe nominal
Il est moins directif que son prédécesseur.
Pronom
Je suis moins rapide que toi.
Groupe prépositionnel
Il est plus détendu qu’au début de l’année.
Adjectif qualificatif
Il est plus bête que méchant.
Adverbe
Il est plus détendu qu’hier.
Proposition subordonnée
Il est plus drôle qu’il n’en a l’air.
Le superlatif relatif isole un élément dans un groupe en affirmant qu’il possède moins ou plus que tous les autres, telle propriété ou tel état.
DEUX TYPES DE SUPERLATIFS
Superlatif d’infériorité
le moins ... de
renforcé par :
de beaucoup / de loin / le moins / de tous / parmi / d’entre / du monde / possible / qui soit
Superlatif de supériorité
le plus ... de
renforcé par :
de beaucoup / de loin / le plus / de tous / parmi / d’entre / du monde / possible / qui soit
NATURE DU COMPLÉMENT DU SUPERLATIF
Adjectif
Cette personne est de loin la meilleure personne qui soit.
C’est une notion de grammaire traditionnelle.
La proposition subordonnée relative adjective est complément du nom qui se trouve à la fin de la proposition principale qui la précède :
Je cuisine les légumes que j’ai achetés.
Le complément du nom est un mot ou groupe de mots qui précise le sens du nom.
NATURE DU COMPLÉMENT DU NOM
Groupe prépositionnel complément du nom
→ Ce qu’il désigne :
-
celui qui fait l’action indiquée par le nom :
Le cours du professeur de français
-
ce sur quoi porte l’action indiquée par le nom :
La lecture du roman
-
celui qui a la qualité indiquée par le nom :
La gentillesse de Luc
-
l’identité de la personne ou de la chose :
La ville de Genève ; le mois de mai ; le royaume de Belgique
→ Prépositions introductrices : à, de, en, sur, pour, contre, avec, dans, au-dessus, en-dessous, etc.
→ Sens : il dépend de la préposition introductrice et des mots ou groupes de mots que cette préposition introduit (origine, destination, lieu, temps, caractéristique, qualité, matière, appartenance [préposition introductrice : “de”], etc.) :
Le train de Paris ; un vol de nuit ; les livres de la bibliothèque ; la maison avec les volets verts ; un peintre de talent ; des flocons de neige ; une température au-dessous de zéro ; une tasse en porcelaine ; une tarte aux pommes ; un reportage sur les ours ; un jour sans soleil ; une tisane contre la toux ; les fruits du verger ; les fleurs des champs , la robe de ma soeur.
→ Les groupes prépositionnels peuvent être emboîtés les uns dans les autres :
Le frère de la voisine de la mère du boulanger.
Proposition subordonnée conjonctive
L'idée qu’ils réussissent.
Le fait qu’ils aient gagné.
PLACE DU COMPLÉMENT DU NOM
Après le nom qu’il complète.
L'adjectif qualificatif précise une propriété de l’élément auquel il se rattache dans la phrase.
NATURE DES COMPLÉMENTS DE L’ADJECTIF QUALIFICATIF
Adverbe
Terriblement long.
Pronom
Il en est fier.
Groupe prépositionnel (complément prépositionnel)
Le groupe prépositionnel se construit avec une préposition à, de, en, pour, avec, etc. :
Plein de sagesse ; satisfait du résultat ; forte en mathématiques ; attentif aux autres ; indifférents à cette situation ;
fâché contre toi ; douée pour la guitare ; généreuse envers ses amies ; serviable avec les autres.
Proposition subordonnée conjonctive
Je suis contrarié que ce colis ne soit pas arrivé.
NATURE DES COMPLÉMENTS DU PRONOM
Un complément prépositionnel
chacun de mes amis
Une proposition relative
toi qui connais bien les plantes
Un complément de comparaison
le même que toi
NATURE DU COMPLÉMENT DE L’ADVERBE
Adverbe
très rapidement
Un complément circonstanciel est un mot, un groupe de mots ou une proposition qui apporte des précisions sur les circonstances de l’action exprimée par la phrase.
Il introduit une circonstance : il précise un élément du cadre dans lequel se situe le fait rapporté :
Hier, au musée, nous avons vu une exposition intéressante.
Un complément circonstanciel n’est pas un complément essentiel du verbe.
Il est en général facultatif et mobile :
Hier, au musée, nous avons vu une exposition.
Nous avons vu une exposition, hier, au musée.
Hier, nous avons vu une exposition au musée.
Hier, nous avons vu une exposition.
Nous avons vu une exposition au musée.
Nous avons vu une exposition.
La nouvelle grammaire française le nomme “complément de phrase” parce qu’il apporte simplement une précision sur l’ensemble de la phrase.
NATURE DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL
Groupe prépositionnel
Sur la terrasse
Nom ou groupe nominal
Place du Général de Gaulle
Adverbe
Ici
Gérondif
En partant
Proposition subordonnée
Conjonctive :
Tandis qu’il pleut
Participiale :
Le printemps étant de retour
Sans connecteur non participiale
LES DIFFÉRENTS COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS
Le complément circonstanciel peut exprimer toutes sortes de circonstances :
Temps
Il a fait beau aujourd’hui.
Lieu
A la campagne, il y a beaucoup de tracteurs.
Moyen
Nous voyagerons en voiture.
Manière
Il parle fort.
Accompagnement
Elle discute avec des amies.
Cause
Cette terrasse est ensoleillée en raison d’une bonne exposition.
Conséquence
Nous avons tellement marché que nous sommes épuisés.
But
Je mets un pull pour ne pas prendre froid.
Concession
Il fait encore beau malgré l’heure tardive.
Opposition
Loin d’être satisfaisant, c’est parfaitement injuste.
Condition
Avec un peu de chance, nous arriverons à l’heure.
Comparaison
Elle chante comme un rossignol.
Certains compléments circonstanciels n’entrent dans aucune des catégories généralement retenues :
Pour moi, il réussira. (Pour moi = à mon avis)
LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE TEMPS
SENS DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE TEMPS
Date
Moment où se déroule l’action :
Je rendrai ce travail demain.
Date relative
Moment de l’action défini par rapport au moment d’une autre action :
Je rendrai mon travail avant demain midi.
Durée
Temps qui s’écoule pendant que se déroule l’action :
J’ai travaillé pendant toute la journée.
COMMENT RECONNAÎTRE LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE TEMPS ?
En posant des questions telles que :
Quand ? Jusqu’à quand ? Pendant combien de temps ? etc.
NATURE DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE TEMPS
Nom ou groupe nominal
Nous reviendrons mardi.
Adverbe
Nous reviendrons bientôt.
Gérondif
En partant, nous ferons le plein.
Proposition subordonnée conjonctive
Alors que je me rendais à la bibliothèque, j’ai rencontré une amie.
Proposition subordonnée participiale
Je viendrai vous voir une fois mon travail terminé.
Groupe prépositionnel
Nous partirons à la tombée de la nuit. Nous mangerons avant de partir.
Prépositions et locutions prépositionnelles introduisant un groupe prépositionnel complément circonstanciel de temps :
-
Date :
À, dès, à la fin de, après, au début de, au milieu de, avant, avant de, dans, jusqu’à, lors de, pendant, à partir de, sous, autour de, aux alentours de, aux environs de, non loin de, près de, sur, vers; etc.
-
Durée :
Durant, en, pendant, depuis, pour, au long de, tout au long de, etc.
LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE LIEU
SENS DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE LIEU
Il précise l’endroit où se déroule l’action
Il lit au bord de la rivière.
Il exprime parfois un mouvement, une direction
D’ici, on aperçoit les sommets des montagnes.
COMMENT RECONNAÎTRE LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE LIEU ?
En posant la question :
Où ?
NATURE DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE LIEU
Groupes nominal
Il travaille rue Paul-Bert.
Adverbe
Ils ont pique-niqué ici.
Proposition subordonnée relative substantive
Vous pique-niquerez où vous voudrez.
Groupe prépositionnel
Ils ont pique-niqué au bord du lac.
Ils ont mangé chez nous.
Prépositions et locutions prépositionnelles introduisant un groupe prépositionnel complément circonstanciel de lieu :
-
Position :
À, dans, en, sur, sous, derrière, devant, chez, contre, à côté de, à droite de, à gauche de,
à l’avant de, à l’arrière de, à proximité de, au bas de, au centre de, au-dedans de,
au-dehors de, au-dessus de, au-dessous de, auprès de, aux abords de, en face de, etc.
-
Direction :
Jusqu’à, en direction de, vers, etc.
-
Origine :
De, depuis, de derrière, de devant, dès, de dessus, de dessous, etc.
-
Passage :
À travers, au travers de, par, via, par-dessus, par-dessous, par-devant, par-derrière, etc.
LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE MOYEN
SENS DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE MOYEN
Il désigne l’instrument avec lequel l’action est réalisée ou la façon dont l’action est réalisée
Il jardine avec de bons outils. (les bons outils rendent la réalisation de l’action possible)
COMMENT RECONNAÎTRE LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE MOYEN ?
En posant la question :
Comment ?
NATURE DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE MOYEN
Gérondif
J’ai ouvert en forçant la serrure.
Groupe prépositionnel
J’ai ouvert la porte avec la clé.
Prépositions et locutions prépositionnelles introduisant un groupe prépositionnel complément circonstanciel de moyen :
À, avec, par, à l’aide de, au moyen de, grâce à, moyennant
LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE MANIÈRE
SENS DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE MANIÈRE
Façon dont se déroule l’action (état d’esprit, etc.)
Il jardine avec plaisir.
COMMENT RECONNAÎTRE LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE MANIÈRE
En posant la question :
De quelle manière ?
NATURE DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE MANIÈRE
Adverbe
Il a délicatement entrouvert la porte.
Gérondif
Il m’a ouvert en souriant.
Groupe prépositionnel
J’ai ouvert la porte avec empressement.
Prépositions et locutions prépositionnelles introduisant un groupe prépositionnel complément circonstanciel de manière :
Avec, de, en
avec empressement, de bonne humeur, en amateur
LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL D’ACCOMPAGNEMENT
SENS DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL D’ACCOMPAGNEMENT
Il montre celui qui accompagne celui qui fait une action
Il jardine avec les enfants. (les enfants accomplissent l’action en même temps que le jardinier)
COMMENT RECONNAÎTRE LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL D’ACCOMPAGNEMENT ?
En posant des questions telles que :
Avec qui ? Sans qui ?
NATURE DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL D’ACCOMPAGNEMENT
Groupe prépositionnel
Je suis rentrée avec les voisins.
Prépositions et locutions prépositionnelles introduisant un groupe prépositionnel complément circonstanciel d’accompagnement :
Avec, en compagnie de, etc.
LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CAUSE
SENS DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CAUSE
Il indique la cause d’une action
Il n’y a plus de gâteau parce qu’on a tout mangé.
COMMENT RECONNAÎTRE LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CAUSE ?
En posant la question :
Pourquoi ?
NATURE DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CAUSE
Proposition subordonnée conjonctive
Je cours parce que je suis en retard.
Proposition subordonnée participiale
Le réveil n’ayant pas sonné, je suis en retard.
Gérondif
En voyant l’heure, je me suis dit que j’étais en retard.
Groupe prépositionnel
A cause de mon retard, je dois courir.
À ces mots, il se fâcha.
Prépositions et locutions prépositionnelles introduisant un groupe prépositionnel complément circonstanciel de cause :
Pour, à cause de, en raison de, parce que, à, etc.
COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CONSÉQUENCE
SENS DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CONSÉQUENCE
Il indique le résultat, l’effet d’une action :
Il a tellement crié qu’il n’a plus de voix.
COMMENT RECONNAÎTRE UN COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CONSÉQUENCE ?
En posant des questions telles que :
Quelle est la conséquence ? Jusqu’à quel point ?
NATURE DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CONSÉQUENCE
Proposition subordonnée conjonctive
Ils ont tellement hâte d’arriver qu’ils se mettent à courir.
Groupe prépositionnel
-
il est toujours composé d’un infinitif ou un groupe infinitif :
Ils courent à en perdre haleine.
-
il peut se rencontrer après un adjectif attribut du sujet :
Il est maigre à faire peur. (Il est tellement maigre qu’il fait peur)
Prépositions et locutions prépositionnelles introduisant un groupe prépositionnel complément circonstanciel de conséquence :
À, au point de, etc.
COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE BUT
LE SENS DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE BUT
Objectif, finalité recherchée, intention de l’action
Les portes du théâtre se sont ouvertes tôt pour laisser entrer les spectateurs.
COMMENT RECONNAÎTRE LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE BUT
En posant la question :
Dans quel but ?
LA NATURE DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE BUT
Proposition subordonnée conjonctive
Nous réaménageons la gare pour que les usagers s’y repèrent plus facilement.
Groupe prépositionnel
La gare sera réaménagée pour le confort des voyageurs.
La gare sera réaménagée pour mieux accueillir les usagers.
Prépositions et locutions prépositionnelles introduisant un groupe prépositionnel complément circonstanciel de but :
Pour, afin de, de façon à, en vue de, etc.
COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL D’OPPOSITION
LE SENS DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL D’OPPOSITION
Il met en opposition deux faits
Loin d’être en difficulté financière, il est certainement le plus riche d’entre nous.
LA NATURE DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL D’OPPOSITION
Proposition subordonnée conjonctive
Alors qu’il aurait dû marcher, il s’est mis à courir.
Groupe prépositionnel
Au lieu de marcher, il s’est mis à courir.
Locutions prépositionnelles introduisant un groupe prépositionnel complément circonstanciel d’opposition :
Loin de, au lieu de, etc.
COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CONCESSION
SENS DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CONCESSION
Il indique qu’un fait n’a pas eu la conséquence attendue
Nous avons dansé toute la nuit malgré la fatigue.
COMMENT RECONNAÎTRE LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CONCESSION ?
En posant la question :
Malgré quoi ?
NATURE DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CONCESSION
Proposition subordonnée conjonctive
Ils sont sortis alors qu’un avis de tempête avait été lancé.
Proposition subordonnée relative adjective à valeur concessive
Qui que vous soyez, passez votre chemin.
Gérondif
Tout en faisant confiance au skipper, je craignais la tempête.
Groupe prépositionnel
Ils sont sortis malgré l’avis de tempête.
Prépositions et locutions prépositionnelles
introduisant un groupe prépositionnel complément circonstanciel de concession
Malgré, en dépit de, nonobstant (en dépit de, malgré), indépendamment de, etc.
COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CONDITION
SENS DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CONDITION
Il exprime un fait dont la réalisation est nécessaire pour que l’action ait lieu
Si nous passons par l’Auvergne, nous vous rendrons visite.
COMMENT RECONNAÎTRE LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CONDITION ?
En posant la question :
À quelle condition ?
NATURE DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE CONDITION
Proposition subordonnée conjonctive
S’il y a urgence, appelez-moi.
Proposition subordonnée participiale
Les inscriptions closes, il nous faudrait renoncer.
Gérondif
En prenant l’avion, nous gagnerions du temps.
Groupe prépositionnel
En cas d’urgence, appelez-moi.
Locutions prépositionnelles introduisant un groupe prépositionnel complément circonstanciel de condition :
En cas de, à condition de, à moins de, etc.
COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE COMPARAISON
SENS DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE COMPARAISON
Il introduit une analogie entre deux éléments
Arrête de sauter comme un kangourou !
COMMENT RECONNAÎTRE LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE COMPARAISON ?
En posant des questions telles que :
Comparé à qui ? Comparé à quoi ?
NATURE DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL DE COMPARAISON
Proposition subordonnée conjonctive
Ecoutez attentivement, comme l’ont fait vos aînés.
Groupe prépositionnel
Écoutez attentivement, à l’exemple de vos aînés.
Prépositions et locutions prépositionnelles introduisant le groupe prépositionnel complément circonstanciel de comparaison :
À l’exemple de, à la manière de, à l’instar de, à la façon de, etc.